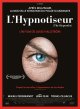- Acteurs : Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek
Sublime et horripilant à la fois, le dernier tour de piste avec Daniel Craig en 007 souffle chaud et froid. Pas de quoi pourtant bouder son plaisir : l’espion britannique n’aura sans doute jamais été si tortueux.
On l’avait bien compris depuis "Casino Royale" (Martin Campbell, 2006) – et "Mourir peut attendre" le martèle de nouveau avec fracas – : l’ère 007 à la sauce Daniel Craig allait résolument placer le célèbre espion sous un nouveau jour, tour à tour plus mature, plus en proie au déséquilibre, à l’angoisse, voire à l’attendrissement. Exit le personnage invulnérable et exclusivement régi par un flegme impassible : le héros n’aura eu de cesse, le temps de cinq films, de frôler chaque fois un peu plus la mort – quitte à flirter délibérément avec –, chaque affrontement lui laissant chaque fois le corps davantage meurtri. Tandis que parallèlement l’amour – autre assaut mais plus cérébral celui-là – aura achevé de réduire sa rigueur inflexible à néant. Si bien que ce Bond-là nous sera avant tout apparu comme un être hanté, par un passé trouble ("Skyfall", Sam Mendes, 2012) comme par un amour malade et incurable (de Vesper Lynd – Eva Green – à Madeleine Swann – Léa Seydoux).
L’héritage de Cary Joji Fukunaga (le réalisateur derrière la saison 1 de "True Detective" ou encore la série "Maniac") s’annonçait donc d’entrée bien lourd à porter. Il incombait au californien (souvent brillant, par ailleurs) de conclure un quintette en beauté, poussant Daniel Craig dans ses retranchements pour son dernier tour dans la peau de 007, et ce, tout en bouclant les arceaux scénaristiques déjà poursuivis dans "007 Spectre". Sans se prendre totalement les pieds dans le tapis – évidemment très épais, le tapis –, le metteur en scène engendre une œuvre somme toute assez laborieuse. Car cette fois le costume de James Bond (qu’on n’appelle plus vraiment 007, notamment parce que l’épisode entend donner à voir et à penser l’homme plutôt que l’espion) implose, souffre de tous les appendices précédemment surajoutés au personnage dans ses dernières aventures. Le réalisateur et toute la production tombent ici dans une ornière avec "Mourir peut attendre", menaçant de s’effondrer (sans tomber pour autant) sous le poids des paradoxes. À force de trop vouloir réinventer le personnage, de chercher à lui redonner de la force tout en le rendant plus humain, ou encore à force de lui subtiliser ses gadgets avant de les réintroduire un film plus loin, James Bond peine à exister naturellement au risque de ne devenir qu’un pantin inconsistant. Si Mendes et sa bande (surtout avec "Skyfall") avaient réussi à dépoussiérer le personnage tout en lui impulsant une nouvelle énergie – génialement nostalgique, d’ailleurs, l’énergie –, la formule ne prend plus aussi bien lorsqu’il s’agit d’en faire comme Fukunaga toute la synthèse. Parce que c’est là toute la difficulté de l’exercice auquel s’adonne le cinéaste américain : redéfinir encore une dernière fois le James Bond à la sauce Daniel Craig tout en parvenant à télescoper ses quatre dernières équipées. Une mission périlleuse et dont l’aboutissement semble parfois presque mal fichu. Aurait-il fallu trancher plus fermement avec les opus passés ou jouer carrément la carte du classicisme décérébré ? La question est épineuse car "Mourir peut attendre" fait justement les deux à la fois – avec une première partie façon montagne russe et une dernière en forme de quête initiatique voire de mausolée.
En découle un film à la fois plein et vide, grandiose et médiocre à la manière de James Bond lui-même qui se dissiperait par excès – ce que le héros finit par faire métaphoriquement ici justement. Le film voudrait exister et briller par son déluge d’effets (ses scènes d’action emphatiques et autres instants de bravoure, ses moments d’intimité…) alors qu’il croule en partie sous un déversoir d’idées – souvent géniales au demeurant, mais pas toujours abouties.
N’allons pas nous méprendre pour autant : "Mourir peut attendre" n’est vraiment pas un nanar, très loin de là. Il s’agit même d’un bon film dans le fond, mais un film malade dont la production houleuse (parce que coûteuse et aux prises d’enjeux énormes, évidemment) se ressent bien souvent. Sa scène d’ouverture, son rythme, son scénario tarabiscoté – entre autres –, en font une œuvre intéressante qui vaut amplement d’être visionnée. Reste que ses morceaux donnent l’impression de ne pas toujours s’imbriquer au bon endroit, de ne jamais ou presque tombés juste. Qu’importe l’histoire, qui se noie pour sa part souvent dans un torrent inaudible et pratiquement inintelligible, on se rassure en admirant les ingrédients phares qui font tout le sel de la licence : l’action parfois débridée et nonchalante, les courses-poursuites, les bolides rutilants , les réceptions aussi fastueuses que vénéneuses, les femmes fatales (mention spéciale pour le tour de piste désopilant aux côtés de l’ingénue Paloma, jouée par Ana de Armas) et autres cascades dantesques. Mieux : on s’étonne de la qualité parfois exceptionnelle de la photographie, de toutes ces contrées magnétiques et mélancoliques visitées par un héros cafardeux sur un laps de temps aussi court (Italie, Jamaïque, Norvège, Îles Féroé, Angleterre…).

Seulement, "Mourir peut attendre" a beau intégrer tous les éléments clés constituant un épisode de James Bond réussi, sa longueur (2h43) – sans compter la musique pompière, calquée sur "The Dark Knight" notamment, signée hélas Hans Zimmer –, sa volubilité parfois trop solennelle et son scénario plutôt confus ne cessent de le faire vaciller. S’agit-il d’un déséquilibre délibéré qui traduirait à la fois l’époque tumultueuse qui est la nôtre en même temps que les meurtrissures de James Bond, cet être à la fois maudit, tiraillé, romantique et plus que jamais passionné ? Peut-être mais rien n’est moins sûr. Ou en ce cas, une autre vision de ce James Bond pas comme les autres, qui ne manquera pas de créer un précédent dans la saga entre thriller d’action et mélodrame, sera nécessaire pour l’éclaircir…