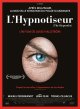Les pépites du polar

- Acteur : Willem Dafoe
Tout le cinéma de William Friedkin miroite dans cette course-poursuite maudite filmée dans un Los Angeles aussi ensoleillé que mortifère. Voici 4 raisons de (re)découvrir cette pépite un peu délaissée, sans oublier ses twists déments.
C’est l’histoire d’une chasse à l’homme épique, d’une traque opposant d’un côté le charismatique fabricant de faux billets Rick Masters (Willem Dafoe), de l’autre le turbulent agent fédéral Richard Chance (Bill Petersen), désireux de venger la mort de son ex coéquipier. Il suffit d’une anicroche et la machine s’emballe jusqu’aux portes de l’Enfer.
Courses-poursuites, démarrages en trombe, saut dans le vide… tout va vraiment très vite dans "Police Fédérale Los Angeles", un peu comme chez Tony Scott mais dans une version qui serait devenue ésotérique et vénéneuse. Cela dit, le côté survitaminé ne tient pas du hasard car c’est précisément l’effet recherché par son réalisateur William Friedkin, alors en quête d’action qui déménage après l’accueil mitigé reçu par l’excellent "Convoi de la peur". Le papa de "L’Exorciste" et de "French Connection" opte donc pour un concentré d’adrénaline à travers l’adaptation du roman autobiographique de Gerry Petievich, ancien membre des services de renseignement américain expert dans la traque des faussaires. En découle un jeu de chat et de la souris virevoltant, un peu à la manière de "French Connection" mais qui tiendrait cette fois encore davantage du voyage, d’une descente aux enfers dans un espace étrange et labyrinthique. Un personnage piégé dans les méandres d’une cité cauchemardesque et qui court droit à sa perte, cela ne vous dit rien ? Eh oui bien sûr, "Police Fédérale Los Angeles" reprend à la lettre les codes classico-classiques du film noir. Voici quatre raisons de (re)découvrir cette petite merveille, à classer parmi les meilleurs longs-métrages de Friedkin.
Pour sa plongée dans un monde clandestin venimeux
Comme presque à chaque fois chez Friedkin, le récit emporte les personnages principaux dans une traversée, une incursion insolite dans un univers occulte. La particularité de cet espace caché, recroquevillé, qu’emprunte le protagoniste au gré de sa mission, est de contaminer irréversiblement son hôte. Ainsi, puisque l’immaculé Richard Chance s’immisce malgré lui dans les bas fonds de L.A., visite ses strip clubs, ses lieux abandonnés, il bascule dans l’interdit et se métamorphose à ses dépens en être décadent. Au sein de cette Amérique corrompue par la brutalité et le crime, Chance se brule les ailes et glisse vers la transgression. Ce sortilège qui s’opère, Friedkin le filme comme une incantation, une malédiction. La ville elle-même, dans ses tons rougeoyants et crépusculaires, apparaît comme ce monstre qui engloutit le personnage. Bien et Mal ne font plus qu’un, Chance finit par se substituer au criminel qu’il poursuit.

Parce que Petersen et Dafoe, antithèses qui se ressemblent
Inconnus ou presque à l’époque de la sortie du film, les deux acteurs n’ont alors que peu de premiers rôles à leur actif. Friedkin change la donne et leur offre un tremplin pétulant, fut-il risqué et transgressif. Dans le rôle du flic Chance, Petersen multiplie les moments de bravoure, entre base-jump et actions endiablées. Willem Dafoe quant à lui, dans la peau de Masters le faussaire démoniaque (la photographie, symboliquement aux prises des flammes chaque fois, insiste sur son côté maudit), sonne comme un monstre presque fatigué, blasé par la perversité et le Mal. D’une certaine façon, la malignité de son personnage s’efface pour laisser celle du prétendu héros advenir. Petersen-Chance et Dafoe-Masters se fondent l’un en l’autre jusqu’à ne plus faire qu’un. Serait-on dans le rêve d’un même protagoniste fou à lier ?
Pour ses courses-poursuites dantesques, parmi les plus dingues de l’histoire du cinéma
Nous évoquions plus haut l’idée de contamination, du caractère délétère et empoisonné de la mise en scène, qui agit comme une damnation (embrasement allégorique du ciel, de la ville…). Eh bien, les courses-poursuites, plus spécialement, sont à disséquer comme des malédictions en acte. À force d’accélérer, de poursuivre, Chance s’enfonce symboliquement dans les Enfers. C’est comme s’il mourait une première fois pour renaître damné. Sur un plan plus terre à terre, les scènes de courses-poursuites en elles-mêmes s’avèrent stupéfiantes, transforment les personnages. Plus loin que "French Connection", Friedkin pousse le motif dans ses derniers retranchements – pas impossible que Cameron s’en soit souvenu pour "Terminator 2". Ces courses-poursuites interminables, dont l’une durant dix minutes aux abords de l’autoroute de L.A. et ayant nécessité 75 cascadeurs, 3 caméras et 1 chef-op spécialisé, s’apparentent à un manège à grandes sensations. L’enchainement des plans, au gré des contretemps, des accélérations, des visions subjectives ou externes, des faux crashs, des twists, des soubresauts, dessine un rêve éveillé hallucinant et halluciné.
Parce que Los Angeles, filmée comme jamais
Avant le L.A. glacé de "Collatéral", avant celui cauchemardé de "Mulholland Drive" ou celui moitié idéalisé moitié effrayant de "Drive" et "The Neon Demon", trône le Los Angeles déliquescent ici dépeint par William Friedkin. C’est simple : la cité des Anges n’a jamais semblé aussi diabolique, hantée par une présence maléfique et écrasante. On se croirait en permanence dans l’introduction du film "Rosemary’s Baby" de Polanski, avec cette vision du ciel liminaire où l’on a le sentiment qu’un diable surplombant New York descend sur Manhattan pour maudire le tout venant. Une apocalypse semble en passe de se produire. Le ciel incandescent absorbe la ville et ses habitants, tandis que les palmiers et les poteaux électriques forment des silhouettes terrifiantes, et non pas rassurantes comme on le conçoit habituellement dans l’inconscient en imaginant les artères ensoleillées de Californie. Le soleil a beau briller, il s’agit d’un soleil noir et trouble. Tout cela tient de la fin du monde et c’est époustouflant de torpeur larvée. Même la musique eighties de Wang Chung n’entache en rien cette atmosphère sidérante, l’une des plus folles du cinéma et qui résume bien le titre original du film, bien plus parlant : "To Live and die in L.A.".