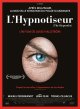Bepolar : Comment est née l’idée de ce roman, A l’abattoir ?
Ovide Blondel : C’est un peu difficile de reconstituer la genèse de ce roman, car j’ai commencé son écriture il y a pas mal de temps… mais je crois que c’est venu de la culpabilité que je ressens (symptômes de temps modernes, je pense que nous sommes sans cesse plus nombreux à nous sentir concernés) quand je mange de la viande. Je sais que les êtres humains ont toujours été carnivores et que nous ne faisons que nous soumettre à notre nature, mais les camps de concentration pour animaux que sont certains élevages d’aujourd’hui et la tuerie de masse qui s’ensuit n’ont plus rien à voir avec les luttes préhistoriques d’une meute d’hommes contre des animaux en liberté.
Je ne suis pas chasseur mais je vois la chasse comme une entreprise bien plus naturelle pour constituer notre stock de protéines animales. Je ne dis pas qu’il faudrait qu’on s’arme tous de fusils pour dégommer la population animale dans la nature, je dis juste qu’il faudrait qu’on se regarde en face quand on mange un sandwich au jambon. Dans notre pain, il y a de l’animal mort. Notre époque n’est pas facile, on se sent coupable de tout, de la misère, de l’exploitation des travailleurs opprimés quand on achète du textile à bas prix ou un téléphone, de la pollution dès qu’on prend notre voiture ou qu’on allume la lumière, de la maltraitance animale dès qu’on mange un poulet-frites, … D’un côté, on nous propose tout, en quantité, accessible en permanence, de l’autre on nous dit de ne pas consommer car ce n’est pas bien. Si j’ai l’air d’enfoncer des portes ouvertes, c’est pour illustrer mon propos et le sentiment de culpabilité du monde moderne ; je ne pense pas que ça ait toujours existé. Jusqu’à il y a quelques dizaines d’années, on pouvait rouler dans une énorme voiture américaine consommant du vingt litres au cent en ne se souciant que de son portefeuille, se pourrir paisiblement les poumons en fumant cigarette sur cigarette à peu près partout, ne pas manger de légumes pendant six mois sans arrière-pensée, boire de l’alcool midi et soir sans se poser des tas de questions sur son alcoolisme latent,… enfin vous avez saisi mon message.
J’essaie de consommer le moins possible car c’est dans ma nature, mais tout ça me perturbe. Notamment pour la viande.
Depuis le début de l’écriture du roman, je me suis beaucoup documenté sur les abattoirs, et j’ai compris également la détresse humaine au sein de ces lieux où on donne la mort. Ce n’est pas mal payé mais c’est un des emplois les plus durs qui existent, les plus perturbants. Certains travailleurs des abattoirs s’y habituent car c’est la vie et que leur vie a toujours été dure, d’autres le réalisent et tentent de l’oublier tandis que d’autres encore éludent la question et développent des pathologies psychologiques, des dépressions. Sans parler des problèmes physiques nés des gestes répétitifs.

Bepolar : Avant qu’un accident ne change sa personnalité, vous nous racontez la vie de Steve Gumuskalem, un solide garçon de 130 kilos qui travaille dans un abattoir et a une vie plutôt tranquille. Comment vous le voyez ? Comment le présenteriez-vous ?
Ovide Blondel : Steve est un être humain, pas spécialement bien dans sa peau. Dans la moyenne je dirais. Un garçon normal, d’une intelligence moyenne, qui gagne un salaire moyen. Il est séparé de la mère de sa fille Cécile, avec qui il vit. Il a une passion, les affiches de cinéma, et adore se détendre dans la nature. Il est d’un tempérament plutôt solitaire, à tendance dépressive. Quand il est dans une phase « basse », il bouffe et se soûle en regardant des films à la télévision. Il est gros par nature et ne fait rien contre, au contraire. Sa jeunesse n’a pas été fantastique mais pas désastreuse non plus. D’un père rigide et d’une mère douce, il a vu les deux côtés de la vie dans son enfance. Si je devais faire le psy une seconde, je dirais que sa mère, qu’il a perdue tôt, lui manque. Il trouve que ce monde manque de douceur.
Bepolar : Il est au départ assez "normal". Vous aviez envie qu’il y ait un sentiment de proximité chez les lecteurs ?
Ovide Blondel : Oui, complètement. Je me suis inspiré d’un ami, décédé pendant l’écriture du roman et à qui j’ai dédié ce livre (il était au courant que j’avais calqué mon personnage sur lui), qui était d’une grande bonhomie. Amical et souriant. On ne pouvait qu’aller vers lui. Pas toujours bien dans sa peau lui non plus, comme Steve, mais de l’extérieur, ça ne se voyait pas – mis à part son physique. Si le lecteur ressent cette normalité et cette proximité, j’en suis ravi. Quand on écrit, on tente de manipuler le lecteur bien sûr, on instille des sentiments de proximité pour ensuite mieux le déstabiliser.
Bepolar : Il va peu à peu basculer dans quelque chose de plus sombre. Mais est-ce qu’avec son difficile travail et sa vie avec peu d’espoir, vous avez eu envie d’en faire une sorte de roman social, parlant aussi de la condition de travailleur des jobs éreintants ?
Ovide Blondel : Oui, j’ai eu envie de faire un roman noir répondant aux thèmes du roman noir. Je n’en lis pas beaucoup car je n’aime pas souvent en général la façon dont ils sont écrits. Trop de violence des mots, de grossièreté, trop d’argot. Je n’arrive pas à aimer l’argot, je n’en emploie pas dans mon langage de tous les jours, c’est comme ça. La grossièreté, oui, mais pour rire – Alain Chabat et « Les Nuls » utilisent la grossièreté avec une grande virtuosité !
J’avais envie de faire un roman noir « épris de politesse ». J’ai utilisé la grossièreté et le langage argotique quand je ne pouvais pas faire autrement. Ça peut vous paraître déplacé, un peu trop délicat de parler de la sorte, mais c’est ce que je ressens. J’avais donc envie de me conformer aux règles du genre – en abordant le thème de la pénibilité du travail, de la misère sociale et culturelle, car ça me touche –, mais à ma sauce. J’ai toujours adoré cette phrase de Brel « les gens ne supportent pas longtemps que quelqu’un ait raison tout seul ». Ça me conforte dans l’idée de faire ce que je veux. Je ne suis pas en train de vous dire que j’ai réinventé le roman noir, je n’ai pas ni ce sentiment ni cette ambition ! Je dis juste qu’il faut parfois faire de petites concessions aux thèmes mais pas au style. Le mien n’est pas révolutionnaire, mais moi non plus. J’espère simplement qu’il reflète ma personnalité et celle de Steve. Et si vous avez entrevu cette notion de roman social, ça me plaît, car c’était un de mes buts.

Bepolar : Le livre est sorti il y a quelques semaines. C’est votre premier roman. Qu’est-ce qui vous a mené jusqu’à son écriture ? Comment vous êtes vous construit en tant qu’écrivain ?
Ovide Blondel : Oui il est sorti il y a quelques mois mais ce n’est pas du tout le premier que j’ai écrit. J’en ai terminés sept pour l’instant, fait paraître un dans une petite maison d’édition locale (le roman s’appelle « Pour un nom »), plus ou moins à compte d’auteur. J’ai envoyé tous mes précédents romans à plusieurs dizaines de maisons d’édition, pour autant de lettres de refus.
Ce n’est pas du tout facile, quand on n’a aucun contact privilégié dans le milieu ou qu’on n’est pas devenu célèbre dans un autre domaine, de trouver une maison d’édition, on le sait. J’ai réussi à me faire accepter par l’une d’entre elle, je suis très content. Les éditions Cairn sont très professionnelles, je suis impressionné et très satisfait. Leur collection « Du noir au sud », axée sur le roman noir, est très riche et très dynamique.
Mais comme on dit en karaté quand on a obtenu la ceinture noire, je suis maintenant au pied de la montagne. C’est du moins comme ça que je le vois. Il faut maintenant que mon roman marche commercialement pour que Cairn puisse me faire confiance pour les prochains. Et j’ai également l’envie (c’était le sujet de « Pour un nom » ) d’avoir beaucoup de bons retours, des prix pourquoi pas, et de plus en plus de lecteurs. Qui n’en a pas envie ?
Quant à la construction de moi en tant qu’écrivain… Je suis sculpteur de métier – marbre, bronze – et j’avais envie de créer quelque chose de plus léger que la sculpture, qui elle, demande énormément de matériel, de logistique. L’écriture, c’est du papier et un stylo. Ou un ordinateur. Qu’est-ce que c’est léger ! Et je n’ai pas cette fausse modestie de celui qui écrit et ne veut pas se définir comme écrivain. Je me sens sculpteur avant tout je crois, mais aussi écrivain. Nous sommes tous plein de choses, moi aussi. Vous n’êtes pas qu’interviewer ou animateur de blog, vous avez un tas de facettes.
Bepolar : Quels sont désormais vos projets ? Sur quoi travaillez-vous ?
Ovide Blondel : J’ai commencé la suite de « Pour un nom », toujours en autofiction. Les retours de « À l’abattoir » m’ont donné envie d’écrire un autre roman noir, je ne sais pas du tout autour de quel thème. Je suis fait d’une matière à lente maturation, et par où que je prenne la question, il faut que j’attende que ça vienne… en écrivant bien entendu.